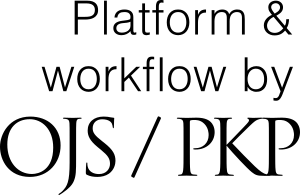Devenir gardien de la paix en France : l’Île-de-France comme contrainte d’affectation
DOI :
https://doi.org/10.26034/la.cfs.2024.4692Mots-clés :
police, recrutement, formation, concours, affectationRésumé
Chaque année, la police nationale française recrute et forme plusieurs milliers de policiers gardiens de la paix, effectifs qui se situent à la base de la pyramide hiérarchique. Ces effectifs, recrutés partout en France, c’est-à-dire en Île-de-France, en province métropolitaine et en outre-mer, sont attendus essentiellement pour des affectations en Île-de-France, où travaillent quatre policiers français sur dix, et d’où partent, a priori pour une meilleure qualité de vie ailleurs en France, davantage de policiers au cours de leur carrière qu’il n’en arrive, par mutation, depuis ces autres territoires français. Cet article, se propose de prendre la mesure de ce que représente cette contrainte dans le recrutement des policiers, à une époque où celui-ci est particulièrement compliqué par un nombre de candidatures bien au-dessous de ce qu’espère l’institution. Cet article montre comment l’administration cherche la bonne stratégie pour relativiser le poids négatif de cette contrainte bien réelle, tandis que les candidats et élèves, de leur côté, progressent dans leur acceptation de cette contrainte.
Références
Chevallier, J. (2010). Révision générale des politiques publiques et gestion des ressources hu-maines. Revue française d'administration publique, 136, pp. 907-918. DOI: https://doi.org/10.3917/rfap.136.0907
Darmon, M. (2006). La notion de carrière : un instrument interactionniste d'objectivation. Politix, n° 82(2), pp. 149-167. DOI: https://doi.org/10.3917/pox.082.0149
Egret, C. (2002). L’esprit de corps au sein de la police nationale : « c’était mieux avant » ?, mé-moire de master 1, Université Paris Cité – Paris Descartes.
Egret, C. (2003). Une première prise de poste (dés)enchantée ? Enquête qualitative sur le vécu de la première prise de poste, en Île-de-France, chez les gardiens de la paix, mémoire de master 2.
Fiolet, C. (2022), Dynamiser la communication de recrutement de la Police nationale : entre impé-ratif d’attractivité et pesanteurs institutionnelles, mémoire de master 2, Sorbonne université.
Gautier, F. (2013). L'entretien de recrutement des gardiens de la paix dans la Police nationale. Paradoxes de l'épreuve et prime à la "compétence interactionnelle". Formation Emploi. Revue française de sciences sociales, 124, pp. 63-86. DOI: https://doi.org/10.4000/formationemploi.4088
Gautier, F. (2015). Aux portes de la police : vocations et droits d'entrée : contribution à une socio-logie des processus de reproduction des institutions. Science politique. Université du Droit et de la Santé - Lille II, thèse de doctorat.
Gautier, F. (2018). Une « résistible » féminisation ? Le recrutement des gardiennes de la paix. Travail, genre et sociétés, n° 39(1), pp. 159-173. DOI: https://doi.org/10.3917/tgs.039.0159
Gautier, F. (2020). Le concours : un levier de transformation de l’institution ? Modalités de recru-tement des gardiens de la paix, réformes de la police et politiques de sécurité. Gouvernement et action publique, VOL. 9(1), 33-55. DOI: https://doi.org/10.3917/gap.201.0033
Gautier, F. (2021). « Policier, ce n’est pas un métier d’intellectuel ». Le capital culturel à l’épreuve du concours de recrutement des gardiens de la paix. Sociologie, Vol. 12(3), pp. 267-284. DOI: https://doi.org/10.3917/socio.123.0267
Gorgeon, C. (2001). Les emplois-jeunes dans la police nationale : à la recherche du conformisme. VEI Enjeux, 124, pp. 132-148. DOI: https://doi.org/10.3406/diver.2001.1189
INSEE (2020). Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines, INSEE Focus n° 210, publié le 21/10/2020.
INSEE (2022). En 2022, les prix en région parisienne dépassent de 7 % ceux de la province. IN-SEE Première n° 1959, publié le 11/07/2022.
INSEE (2023). France, portrait social, édition 2023. Insee références.
Jobard, F., de Maillard, J. (2015). Sociologie de la police : Politiques, organisations, réformes. Armand Colin. DOI: https://doi.org/10.3917/arco.jobar.2015.01
Korell, C. (2019). Police nationale. Denoël.
Labarussiat, F. (2021). L’incidence des évolutions tactiques de maintien de l’ordre sur le lien de confiance police - population : Le cas des manifestations de Gilets Jaunes à Paris (2018-2020), mémoire de master.
Lahire B. (2023). Les structures fondamentales des sociétés humaines. Paris, La Découverte, coll. « Sciences sociales du vivant ».
Malochet, V. (2011). La socialisation professionnelle des policiers municipaux en France. Dé-viance et Société, 2011/3 Vol. 35, pp. 415-438. DOI: https://doi.org/10.3917/ds.353.0415
Malochet, V. (2021). La pluralisation du policing en France. Logiques d’hybridation, effets de tropisme et enjeux d’articulation. Sciences & Actions Sociales, N° 16(3), pp. 53-67. DOI: https://doi.org/10.3917/sas.016.0053
Marchal, E. (2015). Les embarras des recruteurs. Enquête sur le marché du travail, Paris, EHESS, coll. « Cas de figure ». DOI: https://doi.org/10.4000/books.editionsehess.8275
Pabion, B. (2018). Travail de représentation et rapport au politique dans le syndicalisme policier. Thèse de doctorat. Université de Lyon.
Péchenard F. (2019). Lettre à un jeune flic. Tallandier.
Serres, D. (2012). Le capital culturel dans tous ses états. Actes de la recherche en sciences sociales, n° 191-192(1), pp. 4-13. DOI: https://doi.org/10.3917/arss.191.0004
Téléchargements
Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Catégories
Licence
(c) Mathieu Fiolet 2025

Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International.
Attribution — Vous devez créditer l'Œuvre, intégrer un lien vers la licence et indiquer si des modifications ont été effectuées à l'Œuvre. Vous devez indiquer ces informations par tous les moyens raisonnables, sans toutefois suggérer que l'Offrant vous soutient ou soutient la façon dont vous avez utilisé son Œuvre.
Pas de restrictions complémentaires — Vous n'êtes pas autorisé à appliquer des conditions légales ou des mesures techniques qui restreindraient légalement autrui à utiliser l'Œuvre dans les conditions décrites par la licence.
Les termes de la licence ne s'appliquent pas aux titulaires des droits d'auteur. La licence s'applique aux lecteur.trice.s et à la revue.